J’inspire un grand coup, gonfle les joues, retiens ma respiration. Ça y est, ça me reprend. J’ai chaud. Mon esprit s’affole, je perds les pédales, toute lucidité me quitte, c’est la panique.
Mes poumons lâchent enfin l’air retenu et mes épaules s’affaissent. Non mais sans blague. C’est quoi ce sujet ? Je jette un œil au prof qui s’est plongé dans son portable me laissant là, démunie devant ce devoir. Celui qui consiste à raconter un souvenir de vacances, je l’aurais fait de nombreuses fois, mais celui-là, franchement… Comme s’il avait senti mon regard désespéré, il lève la tête, croise mon regard et ajoute.
« Deux heures, mademoiselle Truchet… Deux heures… Mettez-vous donc au travail ».
Je regarde ma copie, regarde le tableau noir, peu inspirée, imaginant un instant qu’il s’efface comme par magie, pour laisser place à quelque chose, n’importe quoi, de plus exaltant.
Un bruit au dehors me tire de ma solitude. Mes yeux quittent alors l’espace sombre de cette classe devenue silencieuse. Ils clignent, piquent, se ferment, s’ouvrent de nouveau et tombent, en bas dans la cour, sur un garçon de mon âge tout aussi noir que je suis blanche. Quel étrange personnage. Quel drôle d’accoutrement. Sa mère, tout aussi lumineuse, discute plus loin avec la directrice. Je souris devant ce tableau insolite que représente ce petit bonhomme sautillant pieds nus sur l’asphalte de la cour. Il tape dans ses mains à grands coups de cymbales que sont ses tongs, chante, semble être loin d’ici. Il n’en faut guère plus à mon imagination fertile, pour quitter la France vers une Afrique profonde, inconnue et mystérieuse et je me retrouve, aux côtés du jeune garçon, propulsée dans je ne sais quelle cour de terre battue. Je regarde mes orteils nus et poussiéreux s’agiter dans des claquettes crasseuses aux couleurs autrefois vives, aujourd’hui fanées et assurément trop grandes pour moi. Mes yeux remontent, s’attardent sur mes mains d’ébène, ma robe légère qui laisse glisser sur ma peau un air moite et chaud. Mes doigts tâtent mes joues rondes, mes lèvres généreuses, caressent mes cheveux ras et crépus. Quelle curieuse sensation. Tout autour, mes petits camarades se rassemblent déboulant de l’unique chemin, dans cet espace libre de toute végétation. Derrière moi se dresse un bâtiment tout en long, bordé d’une galerie qui distribue une rangée de classes.
Je tourne sur moi-même et fait connaissance avec cette nature sauvage et désordonnée. Une forêt dense et sonore entoure le lieu devenu bruyant avec l’arrivée d’enfants de toutes sortes. Un bouquet de biquettes naines s’égaye plus loin, chassé par un gamin. Des fillettes aux robes bigarrées se trémoussent, jouent à « tape-tape », répètent des ritournelles endiablées. D’autres, plus grands, sans doute plus sages, vendent de petits beignets agglutinés dans des seaux. Ma main leste s’empare d’une pièce au fond de ma besace en loque et je croque avec gourmandise dans la chose collante à la douce saveur. Le soleil pointe son nez au-dessus de nous, il est encore tôt lorsqu’un vieil homme à la barbe toute blanche, frappe dans ses mains, ordonne un alignement devant les classes. Le silence tombe d’un coup. Les écoliers au garde-à-vous ne bronchent plus, ne gigotent plus. Dans un calme parfait ils disparaissent dans les classes. Je me retrouve là, perdue, ne sachant où aller.
« Léopoldine, tu dors » ? m’enjoint le maître impatient.
Je me dépêche, entre, trouve ma place, m’affale sur le banc d’un pupitre digne des brocantes. Je passe ma main sur le bois rêche, pousse un léger nuage de craie dans l’allée centrale, tape mes mains l’une contre l’autre. Ici, c’est le chaos, le maître discute dehors avec un autre. Les élèves livrés à eux-mêmes font du bruit, ça, c’est universel. Sur les murs, de grands dessins noirs et blancs, sans doute fait par le maître des lieux, représentent : une maman qui pile le “Foufou“, un enfant malade, l’appareil digestif d’un ruminant, la carte du Togo. Le vieux tableau noir, prometteur d’une journée bien remplie, est couvert d’une belle écriture, parsemée de fautes. À droite, la lecture. Au centre, la leçon d’histoire. À gauche, le problème de maths. Le maître entre, badine à la main. Il passe dans l’allée et distribue de petits coups secs sur les épaules, les bras, les dos des enfants turbulents. Le calme s’installe, la leçon peut commencer. Et je la trouve captivante, bien plus que le devoir que monsieur Francis me demande de produire. Je cherche l’horloge murale pour évaluer le temps qu’il me reste. Je n’en trouve pas, évidemment. Je décide de braver le saint ordre scolaire, tant pis, je reste…
Je reste, emplis mon esprit de souvenirs d’un autre monde et laisse ainsi Balthazar m’initier aux jeux locaux. Me voilà courant, main tendue, poussant à travers la cour un long bâton terminé par une petite roue – fruit de l’arbre à roue – qui rebondit sur le sol inégal. Je m’amuse à effrayer les biquettes en quête de peaux de fruits abandonnées par les petits. À l’occasion de la rituelle heure de sport, j’empoigne ma machette et Abou me montre comment couper les herbes folles qui envahissent le potager de l’école. Plus tard, revenue dans la pénombre de la classe, j’aide Safia et Honorine à venir à bout de cet improbable problème de mathématiques. Observe, écœurée mon petit voisin grignoter son ridicule morceaux de craie. À l’heure la plus chaude, assise à même le sol à l’ombre de la galerie, je plonge mes doigts dans un bol de « Foufou », d’où s’élève un fort parfum d’épices. Je les lèche avec délice. Aussi, alors que le soleil est encore haut dans le ciel, je m’émerveille d’avoir la force de remonter le chemin chaotique de l’école. Je porte sur l’épaule droite mon vieux sac en toile, celle de gauche, une lourde poignée de morceaux de bois qui permettront de cuire le diner. La petite Kadiou s’est agrippée d’une main ferme à ma robe, attendant de moi que je la tire à ma suite. Elle râle. Je tente de garder l’équilibre. J’ai chaud et l’effort laisse couler la sueur sur mon visage, mais quel bonheur. Je ris. Je chante. Elle chante avec moi.
Bien sûr, une sonnerie discordante me ramène en France. Mes doigts engourdis, crispés, lâchent le stylo. En voilà une belle histoire. Une qui répond parfaitement au sujet du jour « Souvenir d’école ». Je regarde ma feuille double avec un large sourire. Non, mais vraiment quel sujet. Je range mes affaires, me lève et vais poser sur le bureau ma plus belle copie. Une comme on en rêve tous d’écrire un jour. Le maitre l’attrape, la soupèse, en tourne les feuillets.
Pas un mot sur cette page blanche.

Photographie de la classe : Melle47
Photographie du haut, tableau noir : Pixabay.

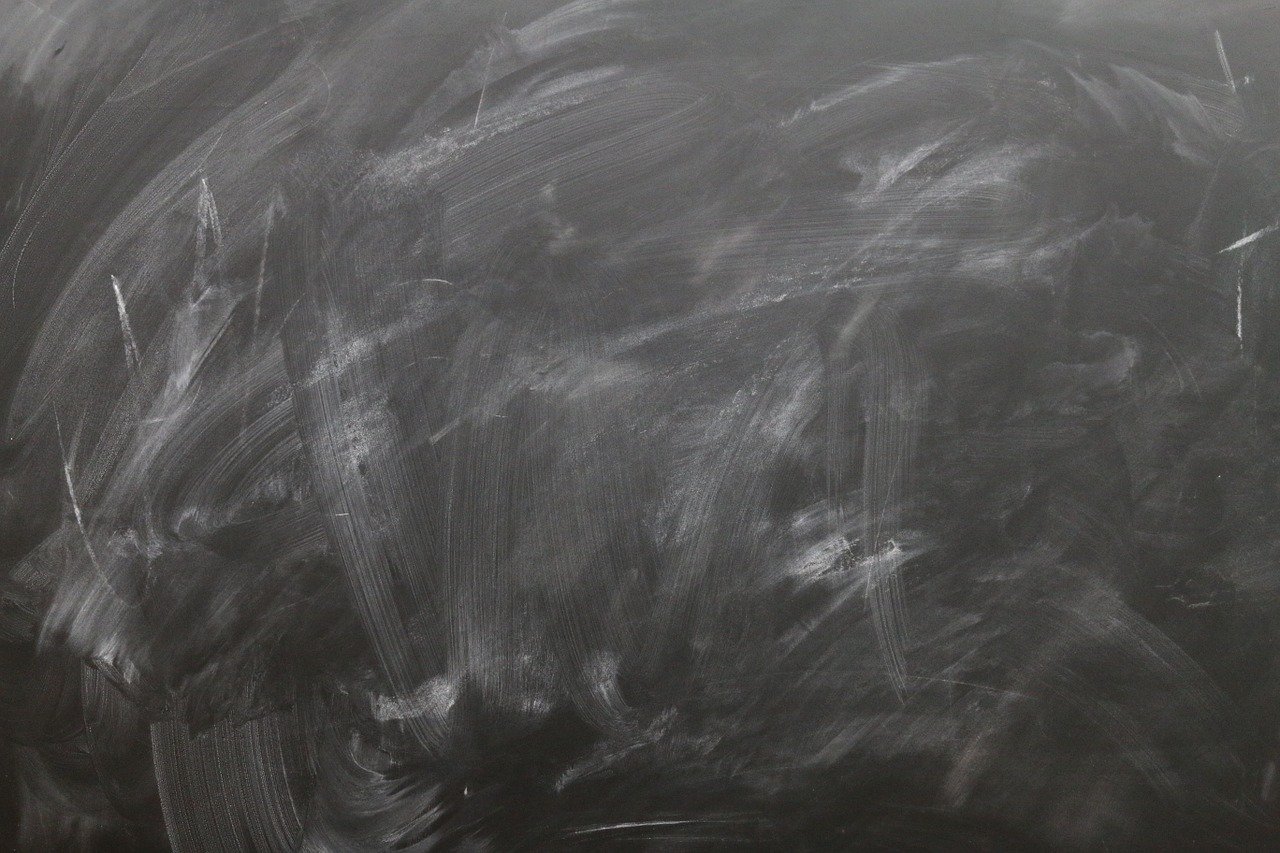
superbe incursion en Afrique: odeurs, couleurs, bruits etc….et toute cette poussière qui envahit l’espace, la chaleur moite, les efforts nécéssaires aprés la journée d’école. tout y est. ce texte est un rêve-docu qui donne à voir ou ressentir une ambiance. c’est trés agréable à lire. ça sent le vécu (oui? non?)
Une spectaculaire évasion en plein devoir de français ! Quelle plume alerte, on y est et même si je ne connais pas du tout l’Afrique noire, j’ai l’impression que c’est très exactement ça. J’ai apprécié les allusions à la différence d’apprentissage des maîtres, et de « discipline » des élèves. Riche idée, et délicieuse histoire !
Je me suis sentie transportée dans ce lieu inconnu, je l’ai découvert au fil du texte avec un immense plaisir. Sans vouloir répéter ce qui est déjà dit, j’ai eu tous mes sens en éveil et même la frustration de ne pas pouvoir goûter au « Foufou ». J’aime aussi beaucoup la construction de l’histoire avec sa chute plus qu’originale.
Très beau ce texte… Pour connaître le Sénégal, je me suis parfaitement retrouvée dans tes descriptions : les couleurs, les odeurs, la chaleur, le bruit. C’est ce qui saute au visage à chaque descente d’avion…
C’est une idée originale et la chute l’est autant. Quel casse-pied ce Monsieur Francis et son sujet à la noix alors que l’Afrique t’appelle…
Tout au long de ma lecture j’avais une petite ritournelle dans la tête : « et les murs de la classe s’écroulent tranquillement,….. le porte-plume redevient oiseau. »
Du Melle47 au goût de Prévert.. Bravo et merci pour ce beau moment de lecture !
À l’occasion de ce très beau texte, on serait tenté de dire magistral (c’est approprié), et en effet comme dit Ktou14 au goût de Prévert, je me suis demandé si derrière (dans le processus de création), il n’y avait pas eu des contraintes auxquelles répondre ou choisies par l’autrice, et du coup, des messages cachés façon mise en abyme. À savoir : 1 – Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir raconter avec sa proposition d’écriture ? (d’où le « Et je la trouve captivante, bien plus que le devoir que monsieur Francis me demande de produire. » qui est un aussi dans la nouvelle « souvenir d’école ») et la chute sur la « page blanche » (qui aurait été le risque implicite pour cet atelier). 2 – Une référence en effet à Prévert avec ce défi épatant et réussi de le transposer en Afrique.
Ensuite la chute, courte et redoutablement efficace, très savoureuse, est tout de même polysémique (ou peut-être n’est-ce que moi qui y voit des sens multiples cachés) : 1- page blanche donc comme je l’ai dit qui était le risque face à cet exercice d’écriture (la nouvelle narre un exercice d’écriture, pour répondre à un exercice d’écriture) 2- page blanche qui fait parfaitement sens dans le texte en écho à la rêverie de Mlle Truchet Léopoldine qui n’a rien écrit (à noter que le prénom me paraît situer dans le temps d’une Afrique coloniale) 3- page blanche parce que la seule élève dans l’école rêvée est blanche. Ça s’appelle une triple bande, félicitations. De fait, je me dis que ma contrainte (contre laquelle il me semble que ça râle de façon cryptée dans le texte) aura été libératrice 🙂 et inspirante puisque contre toute attente puisque l’autrice nous a rendu un superbe texte, et l’enfant s’est évadée.Bref, je suis comme les instits, j’aime à croire que mes tortures font du bien. 🙂
Sinon on sent le vécu, en effet. Je ne me risquerais pas à écrire cela sans l’avoir connu ; j’aurais une totale incapacité à mobiliser les images, sensations (tous les sens sont convoqués)… Que dire, sinon saluer ! Bravo, encore. (Bon, et j’ai appris ce qu’est le >> foufou)
Dommage que la chute soit blanche, c’est un beau rêve.
Melle47, une échappée belle qui transporte loin et avec brio.
Dis donc, tu as trouvé le temps où pour écrire ton texte et bidouiller sur le mien ? Chapeau.
Bravo pour ce texte ! J’ai beaucoup aimé la chute, et l’introduction qui encadrent parfaitement cette expérience togolaise. Une sorte de mise en abyme de cet atelier finalement, et j’ai beaucoup aimé !
Un vrai délice cette histoire, tous les sens sont en éveil… j’ai été transportée avec aisance et légèreté vers ce pays que je ne connais pas… et quelle chute! bravo et grand merci
Merci pour tout vos commentaires 🙂 Francis… oui, il y avait du récalcitrant chez moi quand j’ai lu ton sujet. Léopoldine a su te le dire avec finesse. Mais finalement, oui aussi la torture fût ok puisque le texte a été finalement produit et j’en ai aimé le résultat. Et puis… voilà un rêve enfin réalisé : j’aurais une fois dans ma vie osé rendre copie blanche.